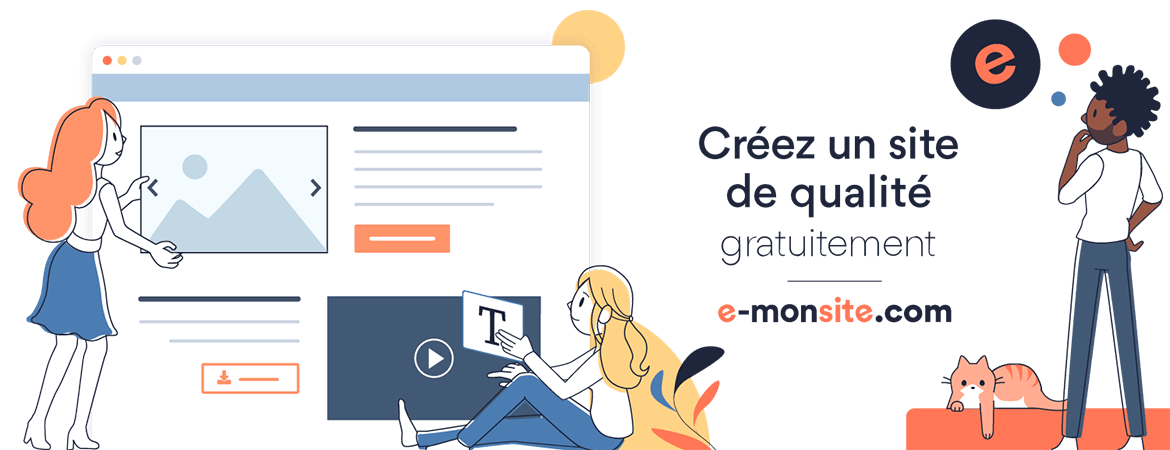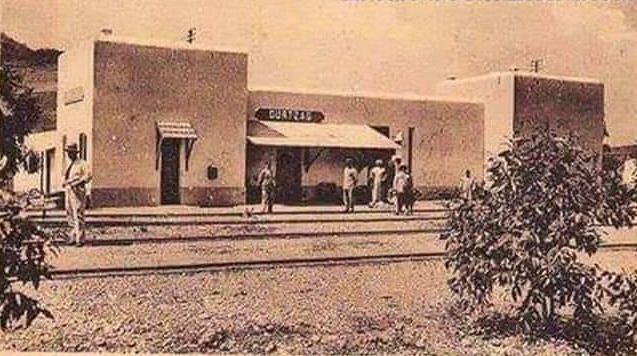Le langage théâtral
wwwwwwwwwwwwwwwww
Texte à lire :
Antigone entrouvre la porte et rentre de l’extérieur sur la pointe de ses pieds nus, ses souliers à la main. Elle reste un instant immobile à écouter.
La nourrice surgit.
LA NOURRICE : D’où viens-tu?
ANTIGONE : De me promener, nourrice. C’était beau. Tout était gris. Maintenant, tu ne peux pas Savoir, tout est déjà rose, jaune, vert. C’est devenu une carte postale. Il faut te lever plus tôt, nourrice, si tu veux voir un monde sans couleurs.
Elle va passer
LA NOURRICE : Je me lève quand il fait encore noir, je vais à ta chambre pour voir si tu ne t’es pas découverte en dormant et je ne te trouve plus dans ton lit!
ANTIGONE : Le jardin dormait encore. Je l’ai surpris, nourrice. Je l’ai vu sans qu’il s’en doute. C’est beau, un jardin qui ne pense pas encore aux hommes.
LA NOURRICE : Tu es sortie. J’ai été à la porte du fond, tu lavais laissée entrebâillée.
ANTIGONE : Dans les champs, c’était tout mouillé, et cela attendait. Tout attendait. Je faisais un bruit énorme toute seule sur la route et j'étais gênée, parce que je savais bien que ce n'était pas moi qu'on attendait. Alors, j'ai enlevé mes sandales et je me suis glissée dans la campagne sans qu’elle s’en aperçoive.
LA NOURRICE : Il va falloir te laver les pieds avant de te remettre au lit.
ANTIGONE : Je ne me recoucherai pas ce matin.
LA NOURRICE : A quatre heures! Il n’était pas quatre heures! Je me lève pour voir si elle n’était pas découverte. Je trouve son lit froid et personne dedans.
ANTIGONE : Tu crois que si on se levait comme ça tous les matins, ce serait tous les matins aussi beau, nourrice, d'être la première fille dehors?
LA NOURRICE : La nuit! C'était la nuit! Et tu veux me faire croire que tu as été te promener, menteuse! D'où viens-tu?
I . Question :
Par quoi se caractérise le texte théâtral ?
II . Réponse :
Le texte théâtral se caractérise par le langage verbal et le langage non-verbal.
Le texte théâtral est écrit pour être dit et pour être représenté. Chaque représentation constitue une interprétation toujours différente du sens du texte ; l'effet produit sur le spectateur, comme la portée de la pièce, sont fonction des choix de la mise en scène. Ainsi, malgré la présence des didascalies, le langage théâtral ne peut être réduit au texte, au discours verbal. Il est donc nécessaire de toujours prendre en compte les autres dimensions du langage théâtral, qui font sens dans la représentation.
Pour lire et comprendre une pièce théâtrale comme « Antigone » de Jean Anouilh, il convient de reconnaître le langage verbal et le langage non-verbal.
Le langage verbal veut dire : ce qui est dit par les personnages dans le dialogue théâtral. La parole d’un personnage ou d’un acteur peut être :
A - Le dialogue : Il est au cœur même de l’action théâtrale et manifeste la présence d’au moins deux personnes sur scène. Il prend différentes formes :
• La réplique : elle constitue la réponse d’un personnage à l’autre.
• La répartie : c’est une réplique brève qui répond à une attaque.
• La tirade : c’est une réplique généralement longue qui argumente sur un sujet dans le registre lyrique ou épique.
• La stichomythie : c’est un dialogue où les personnages se répondent vers par vers et qui donne un style vif à l’échange.
B - Le monologue : Il manifeste la présence d’un personnage seul sur scène, qui se parle à lui-même, ou éventuellement à quelqu’un d’absent, pour exprimer son trouble ou un dilemme. Il permet également au spectateur de connaître les pensées du personnage.
C - Les stances : Elles sont différentes du monologue par leur aspect poétique et traduisent l’émotion du personnage.
D - L’aparté : Ce sont des propos brefs prononcés par un personnage soit pour lui-même, soit à l’adresse du public, à l’insu des autres personnages. C’est un procédé fortement utilisé dans la comédie qui permet de suivre le double jeu des personnages.
Le langage non-verbal signifie : Les didascalies qui sont toutes les indications scéniques, souvent mises en italique, qui vont permettre de fournir des informations au metteur en scène ou au lecteur.
On distingue :
• Les didascalies initiales : elles donnent le titre de la pièce, les listes des personnages, les indications des lieux, le décor...
• Les didascalies internes et fonctionnelles : elle accompagnent le dialogue. C'est le langage non-verbal proprement dit: il concerne tout ce qui est de l'ordre du visuel : le lieu, le décor, la lumière, la gestuelle, le mouvement, les costumes, les accessoires etc... Les exemples, choisis dans le texte lu, illustrent les didascalies relatives à Antigone et à la Nourrice.
Remarque:
Lorsque nous lisons un texte théâtral, nous devons prendre en considération tout ce qui est dit par les personnages ; et tout ce qui écrit par le dramaturge.
Ajouter un commentaire