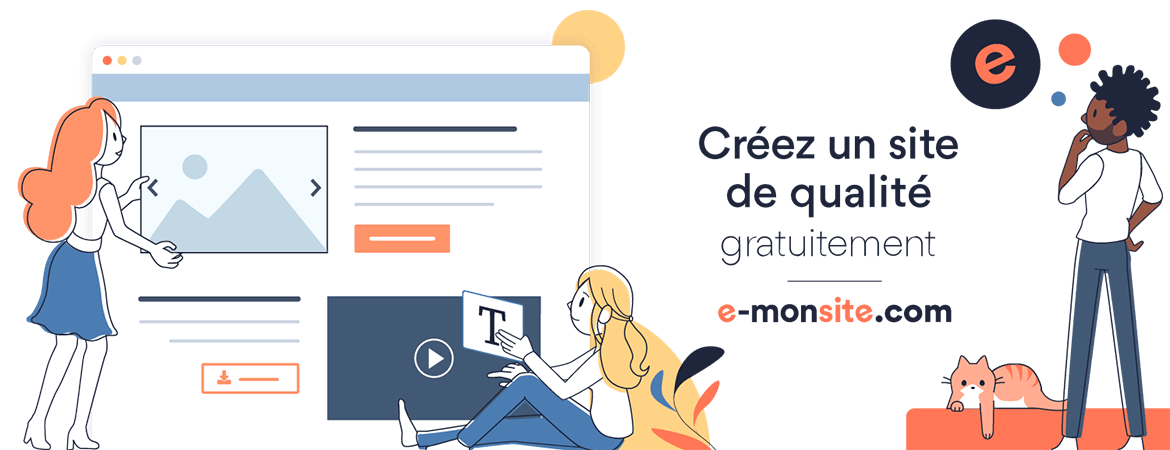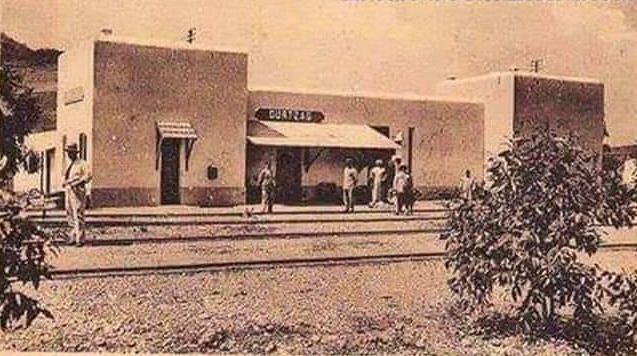Mes élèves , bonjour !
Voilà quelques informations pour lire et comprendre « Le dernier jour d’un condamné »
Mise en situation
Le livre se présente comme le journal qu'un condamné à mort écrit durant les vingt-quatre dernières heures de son existence et où il relate ce qu'il a vécu depuis le début de son procès jusqu'au moment de son exécution soit environ six semaines de sa vie. Ce récit, long monologue intérieur, est entrecoupé de réflexions angoissées et de souvenirs de sa vie passée. Le lecteur ne connaît ni le nom de cet homme, ni ce qu’il a fait pour être condamné (il existe quelques vagues indications qui laisseraient croire qu’il a tué un homme) : l’œuvre se présente comme un témoignage brut, à la fois sur l’angoisse du condamné à mort et ses dernières pensées, les souffrances quotidiennes morales et physiques qu’il subit et sur les conditions de vie des prisonniers, par exemple dans la scène du ferrage des forçats. Il exprime ses sentiments sur sa vie antérieure et ses états d’âme…
Le schéma narratif du récit:
Situation initiale: Le personnage-narrateur menait une vie heureuse avec sa famille, sa fille Marie, sa femme et sa mère jusqu'au jour du crime qui a bouleversé sa vie.
NB: Le récit commence au moment où la condamnation pèse lourdement sur le condamné. Puisque le plus important est la contestation de la peine de mort, l'auteur fait ellipse de cette situation initiale et passe directement aux faits. Toutefois il nous est facile de déduire cette situation initiale à travers les flashes back. (Analepses, retour en arrière).
Elément perturbateur: Le meurtre commis par le narrateur-personnage.
Péripéties: Le jugement, l'emprisonnement, la condamnation à la peine de mort, recherche du condamné d'une solution pour préserver sa vie.
Dénouement: Il n'y a pas de dénouement. Le condamné garde l'espoir jusqu'à quelques moments avant l'exécution, mais à ce moment-là les bourreaux préparent l'exécution. C'est une clausule ouverte, aux lecteurs d'imaginer la fin puisque pour l'auteur ce qui compte c'est la dénonciation de l'horrible peine de mort.
Situation finale: L'auteur a fait l'ellipse de la situation finale pour amener le lecteur à réfléchir.
Personnages
le condamné à mort :
nous ne savons ni son nom ni ce qu’il a fait pour être condamné a mort. Il a très peur et il voudrait être sauvé par la grâce du roi, mais il sait que cela est impossible. Il semble s’être repenti pour ce qu’il a fait. Il est jeune, sain et fort, il a une bonne éducation (il cite des phrases en latin au concierge qui lui permet de faire la promenade une fois par semaine avec les autres détenus, chap. V ; second tome des voyages de Spallanzani dont il lit quelques pages à côté d’une jeune fille, chap.XXXIII). Il dit que pour lui le temps passe plus vite que pour les autres. Il n’aime pas la foule et il ne l’aimera jamais et lui-même n’a jamais aimé voir tuer un condamné à mort. Il aime sa fillette Marie et est très préoccupé pour son futur : chap. XXVI : "Quand elle sera grande ... Elle rougira de moi et de mon nom ; elle sera méprisée, repoussée, vile à cause de moi qui l’aime de toutes les tendresses de mon coeur."
les geôliers:
quelqu’uns sont gentils avec le protagoniste ; d’autres ne le sont pas. Il y a des geôliers qui parlent avec lui et lui demandent beaucoup de choses et d’autres qui le traitent comme un animal.
Sa fillette:
Elle s’appelle Marie et elle a trois ans au moment de sa visite en prison. C’est une fillette qui a très envie de vivre. Mais quand elle parle avec le protagoniste, elle dit que son père est mort (c’est ce que lui a dit sa mère) : elle ne reconnaît plus son père qu’elle ne voit plus depuis plusieurs mois.
Sa femme et sa mère :
Elles ne sont pas décrites ; mais elles sont citées en référence à la souffrance, à la peine indirecte que l’on fait subir aux membres de la famille du condamné a mort : "J’admets que je sois justement puni ; ces innocentes qu’ont-elles fait ? N’importe ; on les déshonore, on les ruine. C’est la justice." (chap.IX)
Le prêtre:
Il est détaché dans ses rencontres avec le condamné. Selon le protagoniste, ce prêtre ne parle par avec son coeur, mais dit seulement de façon machinale ce qu’il dit habituellement avec les condamnés.
La foule :
C’est la société (de Paris) qui veut voir tuer cet homme. Elle est très nombreuse. Elle ne veut pas la justice ; elle veut simplement assister à un spectacle : celui de l’exécution de la peine capitale par la guillotine. On peut donc affirmer que de quelque manière la foule et le condamné sont proches l’une de l’autre au niveau moral.
Composition de l’œuvre.
Le livre est découpé en 49 chapitres de longueurs très variables allant d'un paragraphe à plusieurs pages. Victor Hugo rythme ainsi la respiration du lecteur et lui fait partager les états d'âme du condamné, ses éclairs de panique et ses longues souffrances. On distingue trois lieux de rédaction
Bicêtre où le prisonnier évoque son procès, le ferrage des forçats et la chanson en argot. C'est là qu'il apprend qu'il vit sa dernière journée.
La Conciergerie qui constitue plus de la moitié du livre. Le condamné y décrit son transfert vers Paris, ses rencontres avec le friauche, l'architecte, le gardien demandeur de numéros de loterie, le prêtre, sa fille. On partage ses souffrances, son angoisse devant la mort, sa repentance, sa rage et son amertume.
Une chambre de l'Hôtel de Ville où sont écrits les deux derniers chapitres, un très long relatant sa préparation et le voyage dans Paris jusqu'à la guillotine, l'autre très court concernant les quelques minutes qui lui sont octroyées avant l'exécution.
On remarque aussi plusieurs rétrospectives qui sont souvent des chapitres :
Chapitre II : Le procès
Chapitre IV et V : le transfert et la vie quotidienne à Bicêtre
Chapitre XIII et XIV : le ferrage et le départ des forçats
Chapitre XXVIII : le souvenir de la guillotine
Chapitre XXXIII : Pepita
Descriptions présentes :
celle de Bicêtre au chapitre 4
celle du cachot au chapitre 10
celle de l’Hôtel de Ville au chapitre 37
celle de la place de Grève au chapitre 3
Diverses informations :
chapitre 8 : l’homme compte les jours qu’il lui reste à vivre
chapitre 9 : l’homme pense à sa famille
chapitre 13 :le ferrage des forçats
chapitre 16 : chanson d’une jeune fille lorsque l’homme séjourne à l’infirmerie
chapitre 22 : transfert du prisonnier à la Conciergerie
chapitre 23 : rencontre du successeur au cachot de Bicêtre
chapitre 32 : demande du gendarme par rapport aux numéros de la loterie
chapitre 42 : rêve avec la vieille dame
chapitre 43 : le condamné voit une dernière fois sa petite fille qui ne le reconnaît pas
chapitre 48: transfert à l’Hôtel de Ville
chapitre 49 : on emmène le prisonnier à la guillotine.
Arguments pour la peine capitale
_ Un meurtrier prive un individu de sa vie. De quel droit et au nom de quoi ?
_ Aucun individu ne peut se permettre d'une façon arbitraire de tuer, violer, etc.
_ la peine de mort n'est pas un moyen de répression mais une forme de prévention ou tout du moins de dissuasion.
_ Si la vie est sacrée pourquoi laisser le droit a certaines personnes d'en faire ce qu'elles veulent ?
_ En quoi une société se discrédite en adoptant la peine de mort ?
_. Les crimes commis qui font mériter la peine de mort permettent-ils encore de considérer l’assassin comme un être humain ? Les droits de l’homme ne peuvent par conséquent plus être invoqués quand on parle de peine de mort.
_ Les erreurs judiciaires : il ne faut pas non plus exagérer. Ils sont totalement fiables. O? La question de la condamnation des innocents n’est pas celle de la peine de mort, mais de la faillibilité de la justice.
_. La peine de perpétuité est tout aussi inhumaine : c’est condamner à vivre, tout en sachant qu’on ne sortira jamais. En prison à perpétuité, le condamné perd le peu d’humanité qui lui restait, et devient un animal.
_. Un meurtrier, un violeur etc. n’a jamais l’impression d’avoir fait du mal, on ne peut attendre qu’il mette lui-même un terme à ses jours
_. Il n’existe aucune garantie que les condamnés à mort ou à perpétuité (selon les pays) ne commettront pas à nouveaux leurs crimes s’ils sortent, même très vieux. Mieux vaut supprimer totalement cette probabilité, même si elle est infime. 4. mieux vaut une erreur judiciaire et la condamnation à mort d’un suspect, que la mort de nouvelles victimes qui n’auront même pas eu la chance de passer devant un tribunal. Il y aura toujours plus de victimes de récidivistes libérés après une peine plus ou moins longue, que de condamnés à mort par erreur.
_. Pour un criminel qui deviendra un ange, combien seront libérés sous serment et recommenceront une, dix, cent fois avant d’être repris ?
_. La majorité de la population est pour son rétablissement en France
_. Cela ne fait pas revenir la victime, mais au moins les familles de victimes sont apaisées, car elles savent qu’il n’est plus possible que ce mal frappe à nouveau.
_. il est choquant de payer pour des meurtriers que l’on garde en prison (à moins qu’ils ne paient leur dette contractée envers la société par des travaux d’intérêt généraux par exemple).
_. un récidiviste libéré peut, dans sa vie privée, même s’il se conduit bien dans sa vie publique, reproduire le cercle vicieux dont il a été lui-même victime : personne ne sera là pour vérifier qu’il ne bat pas ses enfants, ou pire, par exemple. Il s’agit donc aussi de casser ce cercle vicieux de la reproduction dont les psy nous parlent tant.
_ Nous ne savons pas si la peine de mort fait baisser le taux de criminalité, mais ce dont on est sûr, c’est qu’elle ne le fait pas monter ! Son impact n’est certainement pas nul. Choisissons donc la solution dont nous sommes sûrs.
_. ce n’est pas être contre les droits de l’homme que d’être pour la peine de mort, puisque la perpétuité bafoue les droits et la dignité de l’homme (575 pers. en ‘9
_. beaucoup de pays dits ‘non- démocratiques’ ont aboli la peine de mort : Angola (1992), Azerbaïdjan (1998), Croatie (1990) ,Equateur (1906), Georgie (1997), Haïti (1987), Honduras (1956), Lituanie (1998), Mozambique (1990), Namibie (1990), Népal (1997), Nicaragua (1979), Roumanie (1989), Timor Oriental (1999), etc .
_. Des pays dits démocratiques ont encore la peine de mort (les Etats-Unis surtout, pour certains Etats, ainsi que le Japon)
_. On fait de l’assassin la victime, en s’occupant de lui et en lui trouvant des excuses (passé, éducation, etc.)
_. Mieux vaut consacrer les ressources limitées dont notre société dispose (hommes, temps, argent, etc.) pour développer celles et ceux qui n’ont fait de mal à personne et qui le méritent largement plus, que de s’occuper des anciens meurtriers et violeurs, pour qu’ils reviennent dans le bon chemin.
Présentation de l'auteur:
Victor Hugo est un auteur français du XIX, il était poète, dramaturge, romancier, … Il tenait aussi une grande place dans la vie politique de son époque, et dénonçait dans ces livres des problèmes de sociétés.
Il est l'inventeur du monologue intérieur et le premier auteur a mêler les niveaux de langues dans ses romans.
Présentation de l'œuvre:
Le Dernier Jour d'un condamné (1829) est un roman, un monologue intérieur. Ce texte nous raconte les six dernières semaines de la vie d'un condamné a mort en attente de son exécution. On partage avec lui ses pensées, ses espoirs, ses peurs, ses angoisses, … Pendant tout le roman on ignorera le nom du condamné et la cause de sa condamnation (on sait juste que le sang à couler). Tout a long du livre on enlève au condamné toute son humanité, il finit par être prêt pour ce qu'ils vont lui faire (Il est dans un état de solitude totale). Ce roman est un réquisitoire contre la peine de mort.
Production écrite :
Sujet : vous êtes avocat. Vous défendez un condamné à mort devant les juges dans un tribunal. Rédigez un plaidoyer dans lequel vous critiquez la loi de la peine de mort.
Mr le juge, messieurs les jurés, mesdames et messieurs, je crois fermement que la peine de mort est horrible, inutile et développe un climat de violence.
Messieurs, je reconnais bien qu’il nous faut lutter contre la criminalité, mais la peine de mort nie l’humanité du condamné : le criminel est considéré comme un assassin qui n'est pas le seul responsable de son crime. Vous oubliez, toutefois, qu’avant tout, c’est un être humain à part entière, une « intelligence qui compte sur la vie, une âme qui ne s’est point disposé pour la mort». Vous allez sûrement me dire que celui qui « tue par l’épée doit périr par l’épée ». Je vous répondrai que la violence n’a jamais été et ne sera jamais une solution contre la violence et qu’on ne peut pas punir un crime en en commettant un autre.
De plus, vous soutenez qu’une exécution publique est exemplaire et moralisatrice. Eh, bien, vous avez tout faux : au contraire, elle rend les gens insensibles et cruels. Ajoutons aussi que des études ont prouvé que l’abolition de la peine de mort n’a jamais entraîné la régression de la criminalité, et, si la peine de mort était aussi efficace, il n’y aurait plus de meurtres depuis longtemps. Ce châtiment n’est, à ma connaissance, qu’un prétendu meurtre légal.
Enfin, le véritable rôle de la justice consiste à corriger les criminels et à leur donner la chance de se réintégrer au sein de la société en leur trouvant du travail et en leur montrant qu’on peut leur faire confiance tout en les surveillant étroitement.
Commentaires
-

- 1. Marc Le 08/03/2025
Hugo explore l'inhumanité du système judiciaire et le fardeau moral de la société, exposant non seulement la souffrance du condamné, mais aussi la cruauté de l'exécution publique. L'ouvrage a influencé l'abolition de la peine capitale en France. -

- 2. Bahia Le 22/10/2023
Merci bien Mr larbi lhand
Ajouter un commentaire